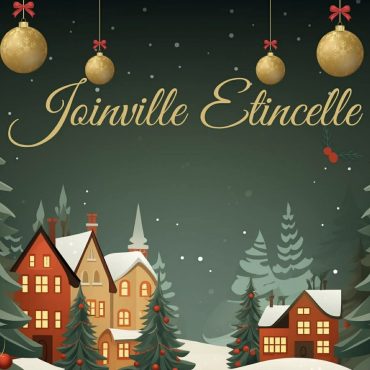Le 20 septembre, le monde entier célèbre la Journée Mondiale des Donneurs de Moelle Osseuse. C’est l’occasion de mettre en lumière un geste d’une importance capitale : le don de moelle osseuse. Il s’agit d’une démarche vitale pour des milliers de patients atteints de maladies graves du sang, comme les leucémies, les lymphomes ou d’autres pathologies de la moelle osseuse. Ces personnes n’ont souvent qu’une seule chance de survie : une greffe de cellules souches hématopoïétiques, et pour cela, il faut trouver un donneur compatible.
Dr Catherine Faucher, Directrice Prélèvement et Greffes de Cellules Souches Hématopoïétiques à l’Agence de la biomédecine set notre invitée
La compatibilité entre un donneur et un receveur est une chance rare. Elle repose sur des critères génétiques spécifiques, et plus le nombre de donneurs potentiels est grand, plus les chances de trouver un “jumeau génétique” augmentent. C’est la mission du Registre National des Donneurs de Moelle Osseuse, géré par l’Agence de la Biomédecine en France. Ils sont à la recherche de nouveaux « Veilleurs de vie » : des personnes en bonne santé, prêtes à s’inscrire sur la liste des donneurs et à offrir l’espoir d’une guérison.
Pourquoi devenir donneur ?
Le don de moelle osseuse est un acte de solidarité qui peut sauver une vie. C’est un engagement personnel qui ne demande qu’une inscription initiale. Il n’est pas nécessaire d’être un donneur de sang pour s’inscrire sur le registre, et les critères sont larges : il faut être en bonne santé, avoir entre 18 et 35 ans lors de l’inscription (on peut rester inscrit jusqu’à 60 ans), et remplir un questionnaire de santé. L’inscription se fait via un simple prélèvement de salive. L’immense majorité des donneurs inscrits ne sera jamais appelée à faire un don, mais pour ceux qui le sont, ils ont le pouvoir d’offrir une seconde chance.
Les deux façons de faire un don, selon l’Agence de la Biomédecine
Contrairement aux idées reçues, le don de moelle osseuse ne se fait pas toujours par une piqûre dans la colonne vertébrale. L’Agence de la Biomédecine précise qu’il existe deux méthodes de prélèvement, choisies en fonction de l’état de santé du patient et de la préférence du donneur :
- Par prélèvement sanguin (le plus fréquent) : Cette méthode est utilisée dans plus de 80% des cas. Elle se déroule de la même manière qu’un don de plaquettes. Le donneur reçoit pendant quelques jours un facteur de croissance pour mobiliser les cellules souches du sang. Le jour du don, il est installé confortablement et le sang est prélevé dans un bras, filtré par une machine qui ne garde que les cellules souches, puis réinjecté dans l’autre bras. Le processus dure environ 3 à 4 heures et est sans douleur.
- Par ponction osseuse : Cette méthode, plus rare, est celle qui est associée à l’image couramment véhiculée. Elle se fait sous anesthésie générale. Le chirurgien prélève, à l’aide d’une seringue spéciale, le sang et la moelle osseuse à l’intérieur des os du bassin. La moelle osseuse se régénère très rapidement. Le donneur peut ressentir une légère douleur au niveau du bassin pendant quelques jours, comme après une chute, mais celle-ci disparaît rapidement.
Chaque don est un acte d’espoir, une chance de vie pour un patient. En s’inscrivant sur le registre des donneurs de moelle osseuse, on devient un maillon essentiel d’une chaîne de solidarité. Ce 20 septembre, pensons à ces « Veilleurs de vie » et à l’importance de ce geste simple qui peut tout changer. Pour plus d’informations et pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de l’Agence de la Biomédecine.

Ensemble, par un simple geste de solidarité, nous pouvons transformer une vie et offrir l’espoir d’un avenir.